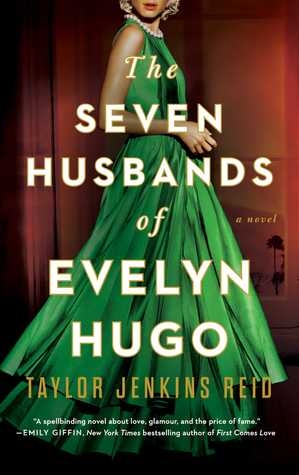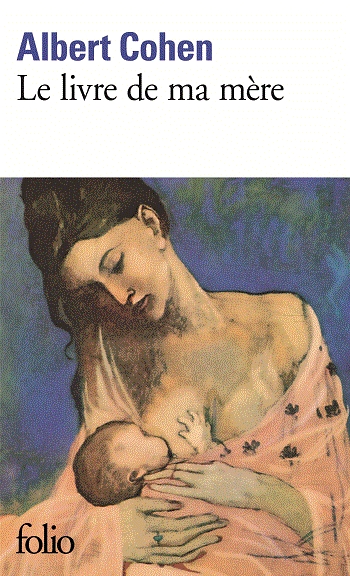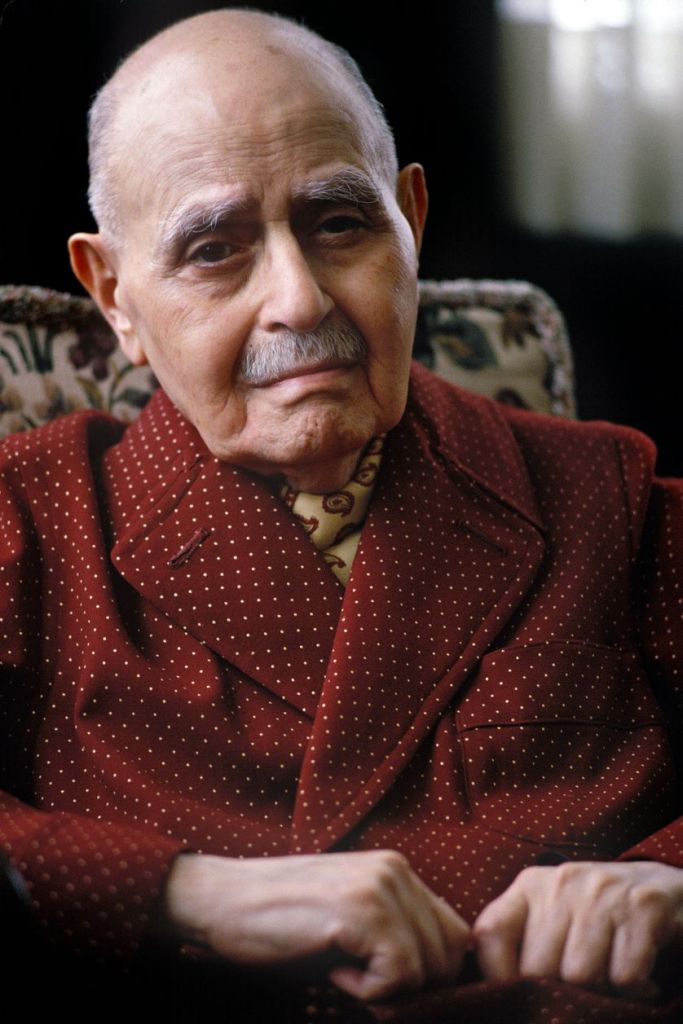Griz vit avec sa famille et ses chiens sur une île au large de l’Écosse. Ses premiers voisins sont à trois îles de là, et les suivants… si loin que ce ne sont sans doute plus des voisins. En fait, si Griz additionnait toutes les personnes croisées au cours de son existence, on pourrait à peine former une équipe de football. Car, une génération après la Castration, la Terre compte moins de dix mille habitants. Et pas beaucoup de chiens.
Alors, quand on lui vole un des siens, son sang ne fait qu’un tour.
Ainsi débute l’épopée de Griz au cœur des vestiges de notre civilisation laissée à l’abandon, avec pour seuls compagnons son autre chien, son journal et la nostalgie d’un monde entraperçu au travers des livres trouvés sur son chemin.
Roman de science-fiction publié par Nouveaux Millénaires en 2019. Titre original : A boy and his dog at the end of the world. Traduit de l’anglais écossais par Pierre-Paul Durastanti.
Je sais bien qu’on ne peut pas éprouver de nostalgie pour ce qu’on n’a jamais connu, mais c’était ce sentiment que les livres m’évoquaient le plus souvent.
Il est de ces livres qui traînent une éternité dans la bibliothèque avant que l’on daigne les ouvrir. Certains d’entre eux auraient mieux fait d’y rester ; d’autres nous aspirent dans un monde que l’on n’aurait pas imaginé, qui ne nous intéressait pas de prime abord, mais dans lequel on aimerait rester. Un gars et son chien à la fin du monde en fait partie. Je ne suis habituellement pas fan de science-fiction, et ce roman apocalyptique au titre quelque peu enfantin ne me faisait pas rêver. J’ai choisi de l’ouvrir trois ans après l’avoir baladé avec moi de bibliothèque en bibliothèque, repoussant le moment de m’y plonger. Finalement, ce livre est une très très bonne découverte.
Le titre et la couverture sont évocateurs. Si le premier inspire très directement la dimension post-apocalyptique du livre, la seconde dépeint un monde en friche où la ville et la végétation se mêlent. Ces deux éléments ensemble crée un air à la fois mystérieux et pourtant pas tant que ça – le titre est équivoque, la quatrième de couverture plante déjà le décor, bref. A première vue, on en sait beaucoup et pas beaucoup à la fois. Pourtant, je peux vous assurer qu’on ne peut pas être prêts pour la lecture de ce livre, tout simplement parce que C.A. Fletcher a un don pour nous balader, nous faire croire des choses, nous manipuler. L’histoire est simple : on suit un jeune garçon dont la chienne a été volée et qui poursuit le ravisseur afin de la récupérer. Il peut vous sembler réagir un peu trop fort, mais la raison pour laquelle Griz, c’est son nom, saute dans son bateau et traverse la mer sans réfléchir, c’est que dans son monde, il n’y a plus beaucoup de chiens. Il y a des années, une Castration a eu lieu et les humains sont devenus pratiquement incapables de se reproduire, ce qui fait qu’ils sont désormais très peu sur Terre ; et les chiens encore moins. La chienne de Griz était donc précieuse.
Ces gens-là sont dangereux, parce qu’ils croient qu’ils agissent sur l’ordre de leur dieu. Ça signifie qu’ils n’ont pas besoin de se comporter comme des êtres humains.
Sa quête nous mène dans les ruines du Royaume-Uni actuel, même si on est assez peu guidés géographiquement – ce n’est pas l’intérêt du livre. Ce qui m’a marquée en tant que lectrice contemporaine, c’est le rapport viscéral qui se tisse entre l’homme et la nature. Les endroits où de nos jours l’humain est roi se retrouvent ensevelis sous les décombres, pillés, massacrés, et la végétation reprend le dessus. Les descriptions d’espaces naturels sont très vivaces dans le roman et donne une toute nouvelle dimension à l’apocalypse, qui tranche radicalement avec ma récente lecture de Ravage de Barjavel dans lequel, au contraire, il n’y a rien de beau dans la fin du monde. Cet ancrage dans une nature luxuriante et le rapport qu’ont les survivants à leur environnement est pour moi l’une des raisons principales pour lesquelles ce roman vaut la peine d’être lu.
Les aventures de Griz sont palpitantes, et, croyez-moi, pleines de surprises, même si la fin est légèrement bâclée à mon goût. La narration est extrêmement bien menée, et je pense que ce qui donne à ce roman tout son dynamisme est le suspense saupoudré tout au long de la lecture. Des petits bons en avant se succèdent, des phrases : « Je ne savais pas encore que cela allait me sauver la vie ». Ce qui pourrait parfois passer pour du réchauffé, de l’anticipation mal amenée, est en fait la touche de baguette magique qui donne envie de dévorer le livre, puisque, oui, on a parfois du mal à s’en détacher !
Il y a de l’action (malgré quelques longueurs), des personnages attachants, et un dénouement en forme de point d’interrogation : Griz va-t-il récupérer sa chienne ? L’aspect post-apocalyptique est bien mené même s’il reste assez peu détaillé. Je pense que cela est parfait pour les novices en science-fiction comme moi : rien de trop complexe qui risquerait de nous perdre. C’est pour cela que je l’ai autant apprécié, mais peut-être que cela pourrait frustrer les puristes (même si j’en ai vu de mes propres yeux adorer ce roman !). L’auteur nous fait parfaitement rentrer dans l’ambiance et cela fonctionne à merveille dans le roman.
Je recommande ce roman aux amateurs de post-apocalyptique qui veulent lire un roman rafraîchissant, aux novices du sujet qui comme moi veulent se sortir de leur zone de confort, et aux amateurs de romans d’aventure qui cherchent à s’évader un peu. N’hésitez pas à découvrir cette petite pépite méconnue !
(Je suis désolée mais je ne trouve pas de photo de qualité pour l’auteur)
CA Fletcher est un auteur écossais qui écrit pour la télévision. A boy and his dog at the end of the world est son premier roman pour adultes.